
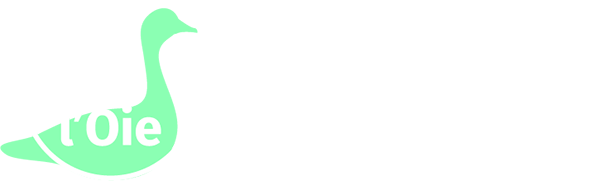

Geoffray Martino
Geoffray Martino, spécialisé en sciences juridiques à Aix-Marseille Université, est membre du Laboratoire interdisciplinaire de droit des médias et des mutationssSociales (LID2MS, AMU). Il participe activement au programme « Droit & Arts » sous la responsabilité de Patricia Signorile.
Son objet d’étude concerne les aspects juridiques de la numérisation des collections publiques. Il est également titulaire d’un diplôme de l’École du Louvre et s’intéresse notamment aux liens qu’entretiennent les institutions culturelles avec les possibilités de préservation et de diffusion offertes par le numérique. Dans un monde à l’arrêt, où le mouvement physique est entravé par la situation sanitaire, le virtuel se révèle un outil essentiel (s’il ne l’est déjà…) en faveur du loisir et de cohésion sociale. L’encadrement juridique du lien entre la diffusion des œuvres relevant d’un patrimoine commun à tous et le numérique revêt donc une importance particulière.

Mon expérience du confinement
« On pourrait penser que rester chez soi, entouré de ses livres, est la posture naturelle du chercheur. Aussi le confinement ne serait a priori pas le plus grand des maux pour lui. Bien que la perspective d’un enfermement chez moi ne m’ait pas effrayé outre mesure, le confinement a tout de même été l’occasion d’une remise en question, un retour aux racines que le temps passé avec soi-même occasionne souvent. Il est vite apparu qu’aller vers l’autre n’était pas une contingence, et que maintenir le lien passait essentiellement à travers les outils numériques.
Cette période exceptionnelle a l’avantage d’être passionnante selon l’approche qu’on en fait ; et s’intéresser aux effets du numérique sur les rapports humains fait partie de ces approches. Si boire un verre seul en visioconférence avec des amis a pu paraître incongru de prime abord, la pratique s’est vite révélée ludique, et les rendez-vous établis avec enthousiasme.
De la même manière, se relier aux autres à travers leur création, en accédant aux contenus numérisés et mis en ligne, est devenu une nécessité. « Sortir » de chez soi n’est jamais eu autant de saveur, et puisque le faire physiquement était difficile, il fallait le faire intellectuellement.
Ce besoin a trouvé une réponse de la part des institutions culturelles, qui ont pendant le confinement ouvert plus largement leurs contenus numérisés. Participant à l’utilisation croissante et massive des outils numériques comme moyen de diffusion, les musées ont pu amener aux amateurs une partie de leur collection ; toujours cependant selon leurs termes, leurs choix de numérisation. En effet, si le numérique est un formidable dispositif de communication, il comporte bien évidemment des limites. C’est par ailleurs ces limites qui expliquent le relatif échec de Google dans son projet de musée virtuel : fondé uniquement sur l’image et ne s’adressant donc qu’à un seul de nos cinq sens, le concept séduit peu. Il manque du son, il manque de l’humain.
L’expérience du musée n’est donc pas seulement celui de la perception visuelle des chefs-d’œuvre, mais également celle d’un univers, d’un lieu sacré qui met les sens en éveil. Le numérique désacraliserait-il ce patrimoine commun ? ou ce sont les choix du géant d’Internet, tourné vers une approche (exclusivement) économique qui ont fait échouer le projet ? Peut-être que le patrimoine commun ne se prête pas si bien qu’on voudrait le croire à la marchandisation, l’aura qui l’entoure doit être préservée pour que la magie opère. Le confinement l’a prouvé : avec peu de moyens, en visio-conférence comme n’importe qui, les chanteurs d’opéra livraient régulièrement des performances qui ont enchanté leur auditoire. C’est donc tout naturellement que la thématique de la numérisation des œuvres dans les collections publiques est réactualisée par le contexte sanitaire actuel et nécessite, d’un point de vue juridique, un encadrement clair qui permettrait de mettre en balance les intérêts de l’institution avec ceux des citoyens, qui ne sont pas les propriétaires des tableaux, mais bien du patrimoine qu’ils représentent. »

