
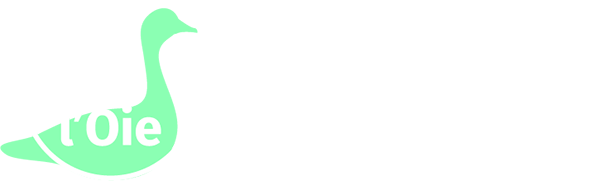

Alessandro Gallicchio
Alessandro Gallicchio est professeur d’histoire de l’art contemporain à l’École supérieure des beaux-arts de Nîmes, commissaire d’exposition et membre associé du laboratoire de recherche Telemme de la Maison méditerranéenne des sciences de l’homme.
Docteur en histoire de l’art contemporain des universités de la Sorbonne, de Florence et de Bonn, il s’intéresse aux rapports entre art, architecture et espace urbain dans les Balkans et en Méditerranée, aux influences du nationalisme et de l’antisémitisme dans la construction du discours artistique et aux esthétiques de la réduction. Entamées à l’Institut national d’histoire de l’art et au centre Pompidou, ses dernières recherches sont à la base du projet art et sciences humaines et sociales Monumed (Monumentalisation et espace urbain dans les Balkans et en Méditerranée) codirigé avec Pierre Sintès, dont l’ouvrage Monument en mouvements. Artistes et chercheurs face à la monumentalisation contemporaine (Gli Ori, 2020) présente les résultats. Lauréat 2020 de la bourse André-Chastel de la Villa Médicis dans le cadre d’un projet qui porte sur les traces urbaines des empires coloniaux en Méditerranée, il explore cette thématique dans l’exposition Rue d’Alger, organisée au sein du programme « Les Parallèles du Sud » de la biennale Manifesta 13 Marseille. En tant que chercheur et commissaire d’exposition, il collabore avec de nombreuses institutions en France et à l’international. Il a enseigné à l’EMCA, à l’ESAG Penninghen, à Sorbonne-Université Abu Dhabi, à l’École du Louvre et à Aix-Marseille Université.
Une liste exhaustive de ses publications et de ses communications dans des colloques ou des journées d’études est consultable sur la page https://univ-amu.academia.edu/AlessandroGallicchio.

Mon expérience du confinement
« Les restrictions des déplacements liées à cette période de confinement ont consolidé le sentiment que travailler sur les relations entre art et espace urbain exige que l’on fasse une « expérience » de cet espace. Cela implique une histoire de l’art « de terrain ».
Ayant vécu deux confinements en pleine conception et organisation d’une exposition qui vise à interroger l’expérience que l’on fait des lieux urbains renvoyant aux passés coloniaux, j’ai été confronté à un obstacle majeur : la restriction de l’accès aux espaces publics. Ce constat, accompagné d’une frustration, s’est manifesté avec force pendant cette période, mais il a commencé en réalité à se manifester bien avant, surtout depuis que j’ai commencé à travailler sur les villes balkaniques et sur leur « commodification » accélérée, ou sur leur « turbo-urbanisme ». Ces dernières décennies, les espaces publics – de plus en plus normés – semblent avoir été vidés de leur fonction d’agrégation pour obéir à des nouvelles stratégies de représentation du pouvoir, qui font appel à des langages artistiques ou architecturaux relevant du processus de la mondialisation. Ces aspects, qui ont déjà fait l’objet de nombreuses recherches en sciences sociales, nécessitent également d’être traités par des disciplines plus jeunes telle que l’histoire de l’art. Loin de voir l’histoire de l’art comme un simple exercice iconographique, je me suis engagé dans l’exploration d’outils méthodologiques qui interrogent la dimension sociale de l’art. Les confinements et le rôle que l’art pourrait jouer dans la reconsidération de l’espace public m’ont fait comprendre l’importance de renouveler mes méthodes et de privilégier davantage le travail de terrain, l’observation, l’immersion et l’« expérience » de la ville. »

